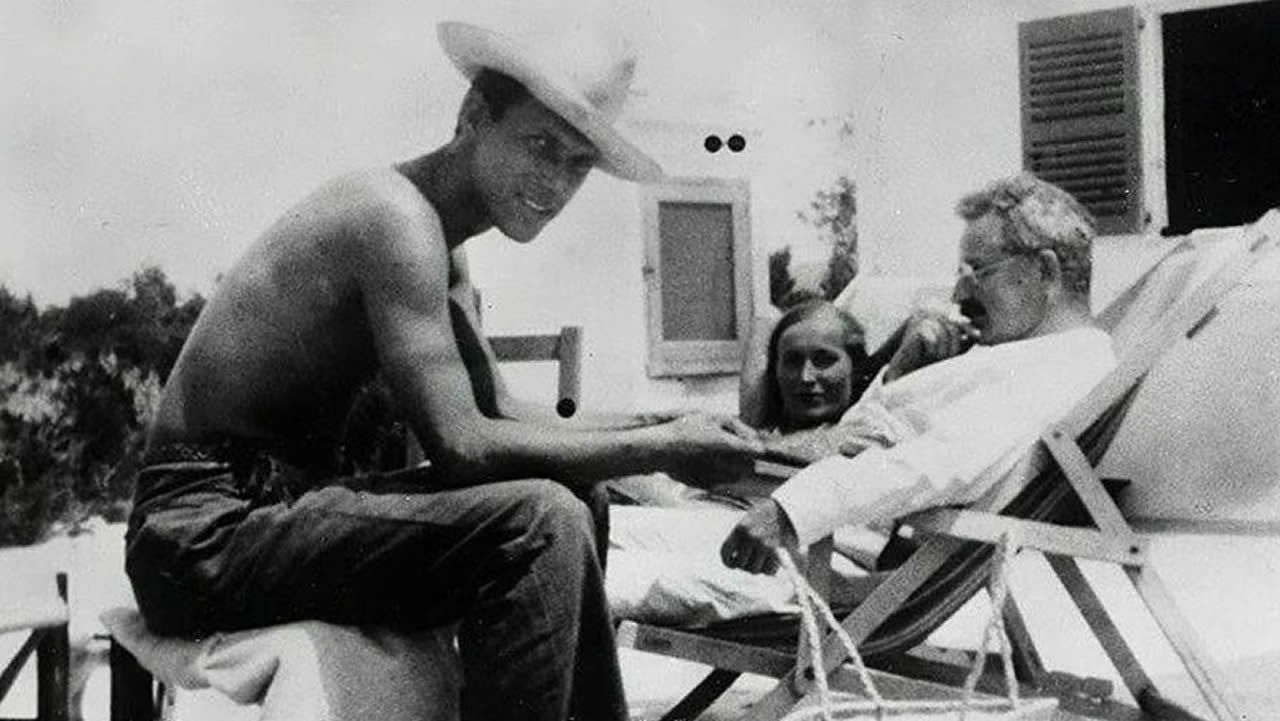“La conviction qui me guide dans mes tentatives littéraires (…) (est) que toute vérité a sa maison, sa demeure ancestrale, dans la langue, que celle-ci est bâtie sur les logoi les plus anciens et qu’en face de la vérité ainsi fondée, les vues des sciences particulières restent subalternes aussi longtemps qu’elles se bornent à prendre leur bien, en quelque sorte comme des nomades, tantôt ici, tantôt là dans le domaine de la langue, captives qu’elles sont de cette conception de la langue en termes de signe qui imprime à leur terminologie un arbitraire irresponsable.” (Briefe, I, 329.) En effet, les mots au sens des premiers essais de Benjamin consacrés à la philosophie du langage[5] sont “le contraire de toute communication réglée sur l’extérieur”, de même que la vérité en général est “la mort de l’intention”. Pour qui cherche la vérité, il en va comme pour cet homme de la légende de l’image voilée consacrée à Saïs : “Ce n’est pas une monstruosité énigmatique de la chose qui motive cela, mais la nature de la vérité en face de laquelle même le feu le plus pur du chercher est éteint comme par de l’eau” (Schriften, I, 131,152).
Depuis l’essai sur les Affinités électives, la citation se trouve au centre de tout le travail de Benjamin. Les essais de Benjamin se distinguent déjà par là des travaux d’érudition de toute espèce, où les citations ont pour fonction de confirmer des opinions, et peuvent donc être renvoyées sans problème dans les notes. De cela il ne saurait être question chez Benjamin. Lorsqu’il préparait son travail sur la tragédie allemande, il se faisait gloire d’une collection “d’environ 600 citations ordonnées de la manière la plus claire” (Briefe I, 339) ; et cette collection comme les carnets plus tardifs, n’était pas une accumulation d’extraits destinés à alléger le travail d’écriture mais représentait déjà le principal du travail, relativement auquel le texte était de nature secondaire. Le principal du travail consistait à arracher des fragments à leur contexte et à leur imposer un nouvel ordre, et cela, de telle sorte qu’ils puissent s’illuminer mutuellement et justifier pour ainsi dire librement leur existence.
Il s’agissait exactement d’une sorte de montage surréaliste. Son idéal — produire un travail constitué exclusivement de citations et par conséquent agencé avec une maîtrise telle qu’il pût se dispenser de tout texte d’accompagnement — peut faire l’effet d’une plaisanterie autodestructrice, mais il l’était tout aussi peu que les tentatives surréalistes contemporaines, qui étaient nées de tendances analogues.
Cependant, dans la mesure où un texte d’accompagnement de l’auteur lui-même était inévitable, il importait à Benjamin de lui donner une forme telle que “l’intention de telles analyses” — “plutôt forer qu’excaver (…) la profondeur de l’idée et de la langue” — fut préservée, et non ruinée par des explications visant à produire un contexte causal ou systématique. Que cette nouvelle méthode de forage ait pour conséquence un certain “forçage des interprétations” dont le pédantisme sans élégance est assurément préférable à la belle allure quasiment générale aujourd’hui des interprétations falsificatrices”, cela lui était tout aussi clair que le fait que sa méthode était vouée à “occasionner certaines obscurités”. Son souci majeur était d’éviter tout ce qui aurait pu rappeler l’“intuition” (Einfühlung), suggérer que l’objet de l’analyse, à chaque fois, contenait un message tout prêt, qui se communiquerait immédiatement ou se laisserait communiquer médiatement au lecteur ou au visiteur : Nul poème n’est destiné au lecteur, nul tableau à l’amateur, nulle symphonie à l’auditeur[g].
Cette phrase, écrite très tôt, pourrait être mise en exergue à tout le travail critique de Benjamin. Et il ne s’agit pas seulement, loin de là, d’agresser un public déjà immunisé, de produire, comme les dadaïstes, un effet de choc par l’arbitraire. Pour Benjamin, il y va bien plutôt d’une conviction : celle que certaines choses, essentiellement de l’ordre de la langue “gardent leur sens, peut-être même leur meilleur sens, lorsqu’elles ne sont pas rapportées a priori exclusivement à l’homme. Ainsi, on pourrait parler d’une vie ou d’un instant inoubliables même si tous les hommes les avaient oubliés. Si l’essence d’une telle vie ou d’un tel moment exigeait d’elle-même qu’on ne l’oubliât pas, ce prédicat ne deviendrait aucunement quelque chose de faux, mais simplement une exigence à laquelle les hommes n’ont pas répondu, et peut-être, en même temps, une assignation à un domaine où elle trouverait sa réponse : à une mémoire de Dieu[6]”. Benjamin a renoncé plus tard à cet arrière-plan théologique, mais non à la chose elle-même ni à la méthode : puiser l’essence dans la citation — comme on puise l’eau par forage à la source souterraine, cachée dans la profondeur. Ce forage est analogue à un exorcisme et ce qui est exorcisé de la sorte et surgit est toujours ce qui a subi le “sea-change” shakespearien, la métamorphose de l’œil vivant en perle et de l’ossature vivante en corail. Chez Benjamin, citer est nommer, et c’est ce “nommer” plutôt qu’un “parler”, le nom et non la phrase, qui portent au jour la vérité. La vérité, pour Benjamin, comme on peut le lire dans l’avant-propos de l’Origine de la tragédie allemande, doit être considérée comme un phénomène exclusivement acoustique : “Ce n’est pas Platon, mais Adam” qui donna aux choses leurs noms, qui est pour lui le “père de la philosophie”. Par conséquent la tradition était la forme dans laquelle étaient transmis les mots qui nomment — elle aussi, phénomène essentiellement acoustique — une “tradition”, comme dit Heidegger, “à l’écoute” de laquelle “il faut se remettre[7]”. Et s’il se sentait une telle affinité avec Kafka, c’est que celui-ci, aussi, quoi qu’en aient dit beaucoup d’interprètes, ne possédait “en rien la capacité de voir à distance”, non plus que le don de “double vue”, mais était aux écoutes de la tradition, “et qui écoute de toutes ses forces ne voit pas”.



 POUR AUTANT que le passé est transmis comme tradition, il fait autorité. Pour autant que l’autorité se présente historiquement, elle devient tradition. Walter Benjamin savait que la rupture de la tradition et la perte de l’autorité survenues à son époque étaient irréparables, et il concluait qu’il lui fallait découvrir un style nouveau de rapport au passé. En cela, il devint maître le jour où il découvrit qu’à la transmissibilité du passé, s’était substituée sa “citabilité”, à son autorité cette force inquiétante de s’installer par bribes dans le présent et de l’arracher à cette “fausse paix” qu’il devait à une complaisance béate. “Les citations, dans mon travail, sont comme des voleurs de grands chemins qui surgissent en armes et dépouillent le promeneur de ses convictions” (Schriften, I, 571). Cette découverte de la fonction moderne de la citation selon Benjamin, qui donnait ici Karl Kraus en exemple, était née d’un désespoir, non de ce désespoir que suscite un passé qui se refuse “à éclairer l’avenir” et laisse l’esprit humain “marcher dans les ténèbres”, comme chez Tocqueville, mais d’un désespoir relatif au présent et d’un désir de détruire le présent. Par conséquent la force de la citation “n’est pas de conserver, mais de purifier, d’arracher du contexte, de détruire” (Schriften, II, 192). Cependant, ceux qui découvraient cette force destructrice étaient originellement animés d’une intention toute différente, l’intention de conserver. Et c’est seulement parce qu’eux-mêmes ne se laissaient pas duper par les “conservateurs” professionnels qu’ils voyaient partout, qu’ils découvrirent finalement que la force destructrice de la citation est “la seule où l’on trouve encore l’espoir que quelque chose de cette époque survive — pour l’unique raison que cela lui a été arraché”. Sous cette forme de “fragments de pensée” la citation a la double tâche de rompre le cours de l’exposition avec “une force transcendante” (Schriften, I, 142-143) et de concentrer en même temps ce qui est exposé. En ce qui concerne leur poids, les citations dans les écrits de Benjamin ne peuvent être comparées qu’aux citations bibliques très dissemblables qui se substituent si souvent, dans les Traités médiévaux, à la cohérence interne de l’argumentation.
POUR AUTANT que le passé est transmis comme tradition, il fait autorité. Pour autant que l’autorité se présente historiquement, elle devient tradition. Walter Benjamin savait que la rupture de la tradition et la perte de l’autorité survenues à son époque étaient irréparables, et il concluait qu’il lui fallait découvrir un style nouveau de rapport au passé. En cela, il devint maître le jour où il découvrit qu’à la transmissibilité du passé, s’était substituée sa “citabilité”, à son autorité cette force inquiétante de s’installer par bribes dans le présent et de l’arracher à cette “fausse paix” qu’il devait à une complaisance béate. “Les citations, dans mon travail, sont comme des voleurs de grands chemins qui surgissent en armes et dépouillent le promeneur de ses convictions” (Schriften, I, 571). Cette découverte de la fonction moderne de la citation selon Benjamin, qui donnait ici Karl Kraus en exemple, était née d’un désespoir, non de ce désespoir que suscite un passé qui se refuse “à éclairer l’avenir” et laisse l’esprit humain “marcher dans les ténèbres”, comme chez Tocqueville, mais d’un désespoir relatif au présent et d’un désir de détruire le présent. Par conséquent la force de la citation “n’est pas de conserver, mais de purifier, d’arracher du contexte, de détruire” (Schriften, II, 192). Cependant, ceux qui découvraient cette force destructrice étaient originellement animés d’une intention toute différente, l’intention de conserver. Et c’est seulement parce qu’eux-mêmes ne se laissaient pas duper par les “conservateurs” professionnels qu’ils voyaient partout, qu’ils découvrirent finalement que la force destructrice de la citation est “la seule où l’on trouve encore l’espoir que quelque chose de cette époque survive — pour l’unique raison que cela lui a été arraché”. Sous cette forme de “fragments de pensée” la citation a la double tâche de rompre le cours de l’exposition avec “une force transcendante” (Schriften, I, 142-143) et de concentrer en même temps ce qui est exposé. En ce qui concerne leur poids, les citations dans les écrits de Benjamin ne peuvent être comparées qu’aux citations bibliques très dissemblables qui se substituent si souvent, dans les Traités médiévaux, à la cohérence interne de l’argumentation. premiers écrits de Kafka — entreprise naturellement incompréhensible pour qui n’est pas bibliophile.) Le “besoin intime de posséder une bibliothèque” (Briefe, I, 193) se manifesta aux environs de 1916 au moment où Benjamin consacrait ses travaux au Romantisme considéré comme le “dernier mouvement qui, une fois de plus, sauva la tradition” (Briefe, I, 138). Qu’une certaine force destructrice fût déjà à l’œuvre dans cette passion pour le passé, si caractéristique des héritiers et des tard-venus, Benjamin ne le découvrit que beaucoup plus tard, quand il eut déjà perdu sa foi en la tradition et en l’indestructibilité du monde. (Nous y reviendrons bientôt.) À ce moment-là, encouragé par Scholem, il croyait encore que si la tradition lui était devenue étrangère, la cause en était probablement sa qualité de Juif, et qu’un retour ne serait pas moins possible pour lui que pour son ami qui se préparait à émigrer à Jérusalem. (Dès 1920, alors qu’il n’était pas encore en proie à de sérieux soucis matériels, il pensait à apprendre l’hébreu.) Il n’alla jamais aussi loin dans cette voie que Kafka qui expliquait, après avoir vu échouer tous ses efforts, que rien de juif ne pouvait lui servir, excepté les récits hassidiques que Buber venait d’adapter pour le lecteur moderne. “Partout ailleurs, je suis seulement comme entraîné d’un courant d’air à l’autre.” Allait-il donc, malgré tous ses doutes revenir au passé allemand et européen et contribuer à la continuité de cette tradition littéraire ?
premiers écrits de Kafka — entreprise naturellement incompréhensible pour qui n’est pas bibliophile.) Le “besoin intime de posséder une bibliothèque” (Briefe, I, 193) se manifesta aux environs de 1916 au moment où Benjamin consacrait ses travaux au Romantisme considéré comme le “dernier mouvement qui, une fois de plus, sauva la tradition” (Briefe, I, 138). Qu’une certaine force destructrice fût déjà à l’œuvre dans cette passion pour le passé, si caractéristique des héritiers et des tard-venus, Benjamin ne le découvrit que beaucoup plus tard, quand il eut déjà perdu sa foi en la tradition et en l’indestructibilité du monde. (Nous y reviendrons bientôt.) À ce moment-là, encouragé par Scholem, il croyait encore que si la tradition lui était devenue étrangère, la cause en était probablement sa qualité de Juif, et qu’un retour ne serait pas moins possible pour lui que pour son ami qui se préparait à émigrer à Jérusalem. (Dès 1920, alors qu’il n’était pas encore en proie à de sérieux soucis matériels, il pensait à apprendre l’hébreu.) Il n’alla jamais aussi loin dans cette voie que Kafka qui expliquait, après avoir vu échouer tous ses efforts, que rien de juif ne pouvait lui servir, excepté les récits hassidiques que Buber venait d’adapter pour le lecteur moderne. “Partout ailleurs, je suis seulement comme entraîné d’un courant d’air à l’autre.” Allait-il donc, malgré tous ses doutes revenir au passé allemand et européen et contribuer à la continuité de cette tradition littéraire ?